J’ai appris à habiter le souffle qui sortait de ma bouche.
Cela s’appelle habiter une langue. C’est mon asile sûr. Celui où je me sens vêtue.
J’entre dans un mot comme au creux d’une grotte creusée par d’autres, où je peux vivre, moi aussi.
C’est cela une langue maternelle. C’est une maison qui accueille. Vous pouvez nicher tranquille. Et c’est immense.
Ça n’a pas de frontière.
Il suffit d’apprendre. Comprenez. Apprendre peut être une merveille.
La langue ne vous demandera jamais votre carte d’identité. Elle est là, disponible dans la bouche de ceux qui vous parlent. Et chacun de nous peut.***
J’ai vu de vieilles femmes admiratives des mots qu’elles ne roulaient pas sous leur palais, habituées à d’autres sons. Intimidées. Puis avec un petit rire, la main légèrement posée sur les lèvres, s’essayant à la nouveauté de la langue inconnue.
C’est naissance.
C’est joie.
C’est grande joie.
Les sons passent d’une bouche à une autre bouche.
On sourit. On rit. On se trompe. On est heureux. On recommence.
Celui qui sait trouver asile dans une langue a trouvé un pays où être chez soi. Il en est l’habitant. Personne ne vous expulsera jamais d’une langue.
C’est comme ça.
Et aucune loi n’y fera rien.
J’en suis convaincue et heureuse.
La liberté est là. Personne n’en tient de fichier.
Ce sont deux poèmes de Comme on respire, de Jeanne Benameur, un joli petit livre violet, chez Thierry Magnier. Il y a dans ce mince recueil, dense, généreux, une sorte d’âpre humanisme militant, que j’estime infiniment, même si je trouve que son expression explicite, jusque dans les deux poèmes cités, fêle l’intensité du propos. Mais il y a aussi cette réflexion sur les mots et la langue, sur la nécessité de dire, d’écrire envers et contre tout. Sur la liberté des mots, dans les mots. Alors, voici.
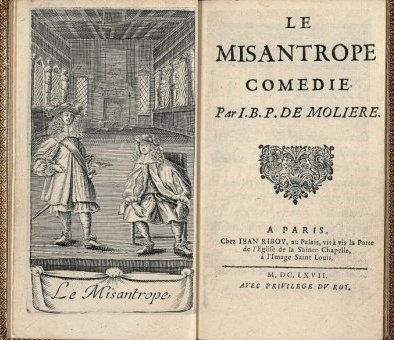



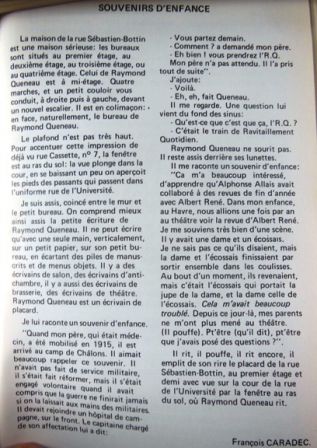


 La Garçonne, de Victor Margueritte. Emprunté(e) à la B.M., puis lu(e) en vitesse
La Garçonne, de Victor Margueritte. Emprunté(e) à la B.M., puis lu(e) en vitesse Il y a dans cet Alexakis nonchalant, hypocondriaque et habité
par tous ses « locataires chimériques » quelque chose du portrait de
Il y a dans cet Alexakis nonchalant, hypocondriaque et habité
par tous ses « locataires chimériques » quelque chose du portrait de
 Photo prise sur le site (en lien) du blog de Vincent Josse.
Photo prise sur le site (en lien) du blog de Vincent Josse.

